Nous recrutons actuellement pour un certain nombre de postes. En savoir plus
Du ciel à la terre : Pourquoi l’Afrique a besoin d’une harmonisation des licences pour une connectivité par satellite inclusive
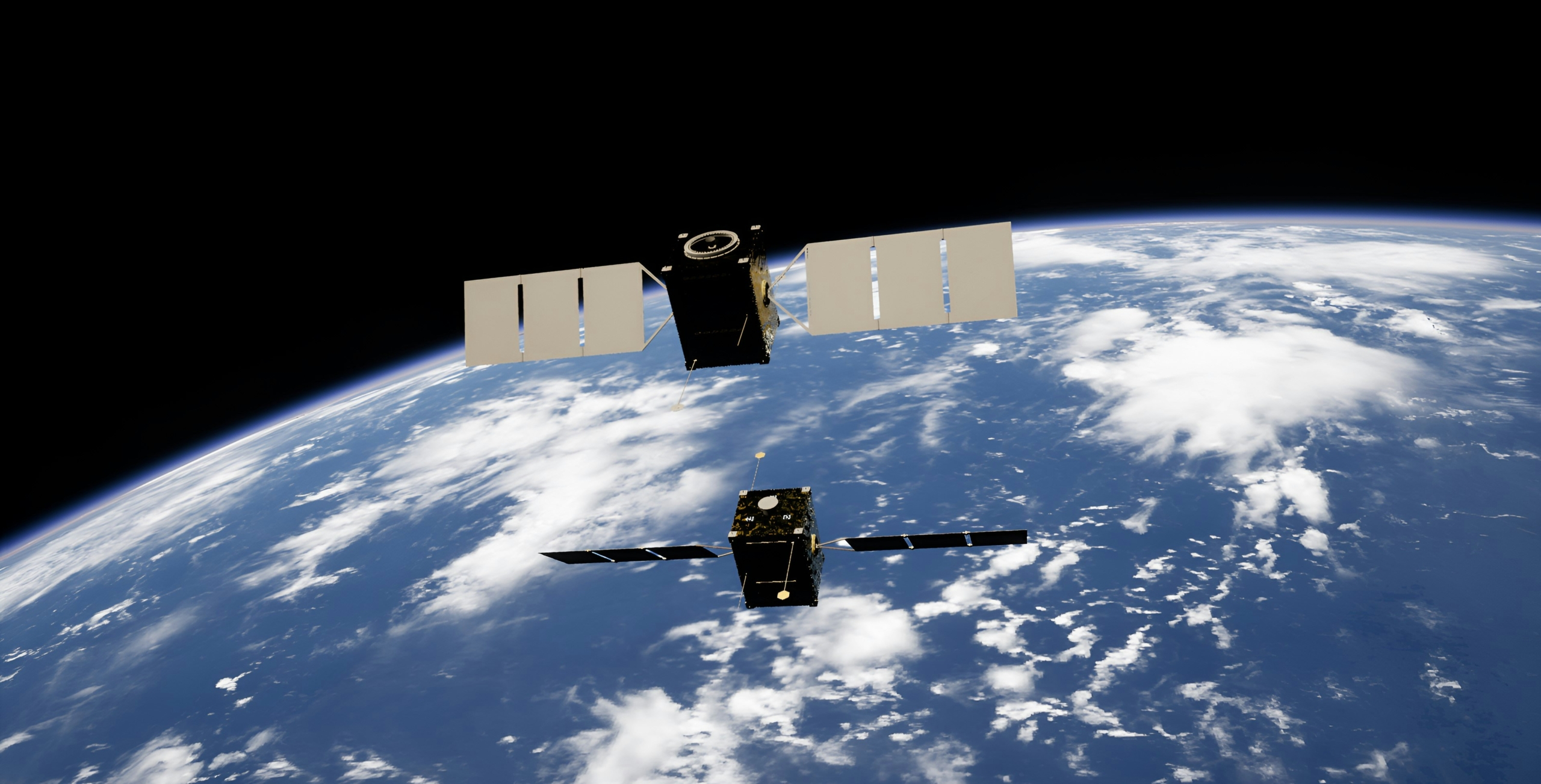
Il existe une frontière discrète mais décisive dans l’avenir numérique de l’Afrique, et il ne s’agit pas des câbles sous-marins, des déploiements de la 5G, ni même des grands slogans sur les « villes intelligentes ». Il s’agit de l’ensemble de règles coordonnées (ou de leur absence) qui déterminent qui peut exploiter des satellites, à quelles conditions et à quel coût. Sans cadres de licences harmonisés, la révolution la plus prometteuse de notre génération en matière de connectivité risque d’être étouffée dans l’œuf par la bureaucratie, le protectionnisme et le flottement politique.
Aujourd’hui, à travers l’Afrique, la connectivité par satellite est peut-être à la fois notre plus grand espoir pour combler la fracture numérique et notre outil le plus sous-utilisé. Les constellations en orbite basse (LEO), comme Starlink et OneWeb, peuvent diffuser un Internet à haut débit vers des villages reculés que la fibre n’atteindra peut-être jamais, connecter des cliniques rurales à des hôpitaux urbains, permettre l’argent mobile sur les marchés de « dernier kilomètre », et relayer des données pour les opérateurs de téléphonie mobile à un coût inférieur à celui du déploiement de nouvelles tours. La propre politique spatiale et la stratégie de transformation numérique de l’Union africaine sont sans équivoque : les communications spatiales sont essentielles à l’intégration économique, à la résilience et à l’inclusion. Mais cette vision pourrait caler au décollage, non pas à cause de la technologie, mais à cause des licences.
Un continent de murs
Plutôt que d’être un marché unifié et fondé sur des règles, le paysage africain des licences de satellite est un enchevêtrement d’exigences nationales et de négociations ponctuelles. La Côte d’Ivoire a explicitement refusé une licence à Starlink pour des raisons de sécurité nationale, alors que, juste de l’autre côté de la frontière, au Ghana, les régulateurs se sont montrés ouverts aux services LEO. En Afrique centrale, le Cameroun a interdit Starlink en 2024, tandis que l’Angola réforme prudemment son régime dans le cadre d’un effort d’harmonisation de la SADC. Pendant ce temps, la Namibie est allée jusqu’à autoriser le commerce de spectre et a accordé des licences en quelques mois, mais le Botswana voisin n’a finalisé l’approbation de Starlink qu’il y a trois semaines.
Certains pays exigent des licences individuelles pour chaque terminal utilisateur, rendant le déploiement de masse économiquement impossible. D’autres exigent des passerelles locales coûteuses ou des participations pour les opérateurs étrangers, même si ces conditions n’ont pas grand-chose à voir avec la gestion de la connectivité et tout à voir avec l’influence politique.
Les frais et les délais varient considérablement : une demande peut prendre des semaines au Lesotho, mais plusieurs années au Soudan ou au Burundi. Sur certains marchés, les licences générales pour les terminaux sont acceptées, et sur d’autres, elles ne sont pas reconnues, ce qui oblige les opérateurs à obtenir des approbations terminal par terminal. Le résultat est un continent de murs : invisibles à l’œil nu mais impossibles à traverser à grande échelle. Les satellites ne reconnaissent pas les frontières. Lorsque les règles changent d’une traversée à l’autre, l’Afrique perd les économies d’échelle qui rendent l’accès universel abordable.
Le coût du désordre
Cette fragmentation réglementaire a trois conséquences distinctes :
- Une inclusion perdue : En Afrique de l’Est, l’Éthiopie a prudemment piloté des règles LEO, mais sans grande clarté publique. Les écoles rurales restent hors ligne pendant que les décisions sont soumises à des processus ambigus.
- Un investissement perdu : Des règles incohérentes repoussent les capitaux sérieux à long terme. Les opérateurs mondiaux ont besoin de licences prévisibles et harmonisées pour s’engager à construire des infrastructures en Afrique. Le refus catégorique de la Côte d’Ivoire et l’interdiction du Cameroun pourraient effrayer les investisseurs qui ont besoin de prévisibilité. Pourquoi engager des capitaux lorsque l’accès peut être révoqué du jour au lendemain ?
- Une souveraineté perdue : Les opérateurs jouent les régulateurs les uns contre les autres. Starlink a obtenu une licence de 10 ans au Lesotho alors qu’il est toujours interdit au Cameroun. Qui détient le pouvoir dans cette dynamique ? Sans une approche de licence coordonnée pour les réseaux non terrestres (NTN), l’Afrique cède son pouvoir de négociation à des acteurs extérieurs qui peuvent choisir les juridictions favorables, ce qui crée une fracture dans l’intégration continentale.
Lorsque chaque pays applique ses propres délais, frais, règles de participation et exigences d’infrastructure, le continent perd les éléments essentiels à sa compétitivité : la rapidité, l’échelle et la certitude.
L’harmonisation est une infrastructure
Les règles harmonisées pour les licences de satellite sont aussi essentielles que les satellites eux-mêmes. Des organismes comme l’Union africaine des télécommunications (ATU), Smart Africa et la CEDEAO ont déjà pris des mesures initiales vers des cadres de référence, reconnaissant les avantages du satellite pour le relais de données et l’approfondissement de l’inclusion. Ces efforts doivent s’accélérer. Nous avons besoin de licences générales pour les terminaux utilisateurs, d’une reconnaissance mutuelle des homologations d’équipement, de droits de débarquement transparents et non discriminatoires, et de frais de licence basés sur les coûts.
À première vue, cela peut sembler être un programme purement technique, mais c’est aussi un enjeu géopolitique. Sans harmonisation, l’Afrique abordera l’ère des satellites comme 54 marchés distincts, beaucoup trop petits pour dicter les règles et vulnérables à être enfermés dans des conditions défavorables. Avec l’harmonisation, nous pouvons présenter un marché unique et attractif qui invite la concurrence, fait baisser les prix pour les consommateurs et protège la souveraineté numérique.
Lancer la conversation
Il y a une occasion à saisir maintenant. Les constellations LEO se développent, les stations terrestres en mouvement (ESIM) permettent la connectivité en déplacement pour la terre, la mer et l’air, et des projets comme Kuiper d’Amazon se préparent à entrer sur le marché africain. L’Afrique doit décider si elle abordera ces opportunités en tant que bloc coordonné ou en tant que fragments déconnectés.
Ceci est le premier d’une série d’articles qui explorera les leviers techniques et politiques pour une véritable politique de licence de NTN panafricaine : en décortiquant les goulots d’étranglement qui ralentissent le déploiement, les modèles qui fonctionnent dans d’autres régions et l’architecture diplomatique nécessaire pour transformer l’harmonisation d’une aspiration en une réalité opérationnelle. Si nous réussissons l’harmonisation des licences, cela pourrait être la station au sol pour l’avenir numérique inclusif de l’Afrique. L’espace pourrait être notre prochaine frontière de souveraineté.
Proud to be BCorp. We are part of the global movement for an inclusive, equitable, and regenerative economic system. Learn more

